Cyrille Dubois et Tristan Raës
Gabriel Dupont
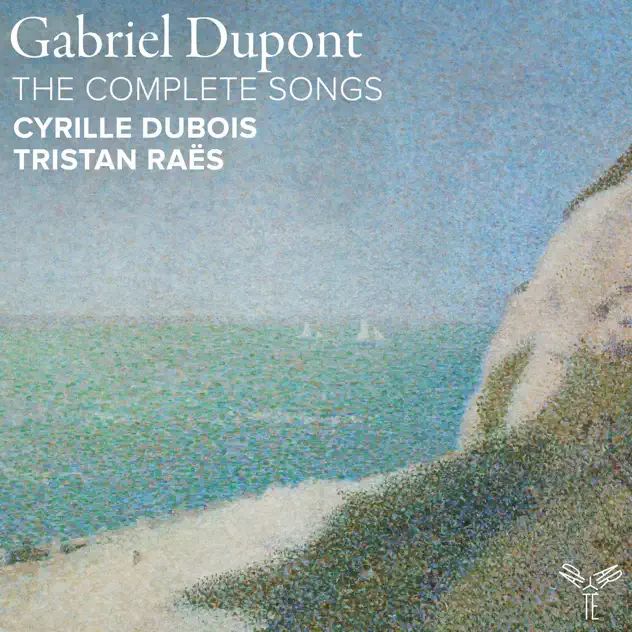
CD Aparté
Ténor de grâce – caractérisation trop limitative –, Cyrille Dubois a enchanté le public toulousain aussi bien chez Britten que dans Offenbach. Sa palette expressive est d’une infinie richesse, son jeu d’acteur varié et engagé. Mélodiste réputé, il a livré des enregistrements de Fauré, des sœurs Boulanger, de Bizet ou de Louis Beydts, autant de modèles de distinction, d’élégance, de musicalité. Explorant des univers toujours nouveaux, il met à l’honneur les mélodies de Gabriel Dupont (1878-1914). Le musicien français, élève de Massenet, deuxième en 1901 au Grand Prix de Rome remporté par André Caplet (Ravel est troisième!), a signé entre autres trois opéras et un beau cycle pour piano Les Heures dolentes. Pour ses mélodies, entre Massenet et Debussy, il emprunte les vers à Verlaine, largement privilégié, à Rimbaud, Musset, Leconte de Lisle, Klingsor, Henri de Régnier, Emile Verhaeren ou d’autres poètes d’envergure moindre. Valétudinaire, atteint par la tuberculeuse, il se plait dans la mélancolie, «la fin des espoirs, [… ] les vaines amours, / Et les songes vains [… ] et la mort des jours» (Georges Vanor, «Le Jour des morts»). Mais quelques pages savent dépasser ce climat morbide. La mélodie française relève d’un art très délicat où toute faute de goût, de ponctuation, de liaison, de respiration pourrait altérer la ligne et l’équilibre – et la beauté parfois un peu gracile – de ces frêles miniatures. Dubois et Raës, indissociables dans la réussite de l’album, réussissent pour chaque pièce à en exprimer la quintessence musicale et poétique, avec simplicité et une maitrise technique et vocale exemplaire. Que retenir des trente et une pages – soit l’intégrale – proposées par les deux complices en harmonie et en discret lyrisme? La tendresse et la justesse. Tous les Verlaine dont le premier «Le foyer», chef d’œuvre pictural où la voix se colore d’inflexions inouïes, sont une leçon de chant. On ne se lasse pas de se laisser séduire par la «Mandoline» «Parmi les frissons de brise». Les trois Richepin dans le cycle Les Caresses mêlent souvenirs pieux, érotisme discret, sensations émues, distillées par Dubois et Raës avec pudeur et sens des nuances raffiné. Barbara composant son «Pierre» se souvenait-elle du «Jardin mouillé»? La «Chanson des noisettes», fable pleine d’humour, animée telle une saynète, le dialogue entre le poète et son cœur dans la «Chanson» de Musset, à laquelle fait écho la «Sérénade à Ninon», la délicieuse «Annie», la discrètement exotique «Chanson de Myrrha» ouvrent l’éventail précieux des climats, des registres, des couleurs, des demi teintes. «La Chanson des six petits oiseaux» ne sombre pas dans la joliesse mièvre que par l’intelligence, le sens de la distinction d’amoureux lucides du compositeur. L’étonnant «Monsieur Destin» dénonce avec une ironie amère, caustique, les illusions. Tout comme dans «Pieusement» de Verhaeren ou «Ô triste, triste» (Verlaine), les deux interprètes introduisent un dramatisme douloureux de bon aloi. Écoutez enfin cette merveille d’art du dire, Crépuscule d’été, sur un texte de la seule poétesse mise en musique par Dupont, Cécile Périn. Ce qu’en fait le compositeur, avec une audace étonnante de dépouillement, relève du respect le plus total, le plus pur de la poésie, de ses rythmes, des enjambements, de la prosodie, du mystère de cette promenade embaumée. Ce que le ténor et le pianiste en traduisent relèvent de l’enchantement et de la grâce. Fade? Comme un haiku, comme un Chardin. Nous sommes au cœur de l’intimité et de l’émotion d’une vie et d’un art. «Tout meurt, / Et cependant tout me semble éternel».
Jean Jordy
Ténor de grâce – caractérisation trop limitative –, Cyrille Dubois a enchanté le public toulousain aussi bien chez Britten que dans Offenbach. Sa palette expressive est d’une infinie richesse, son jeu d’acteur varié et engagé. Mélodiste réputé, il a livré des enregistrements de Fauré, des sœurs Boulanger, de Bizet ou de Louis Beydts, autant de modèles de distinction, d’élégance, de musicalité. Explorant des univers toujours nouveaux, il met à l’honneur les mélodies de Gabriel Dupont (1878-1914). Le musicien français, élève de Massenet, deuxième en 1901 au Grand Prix de Rome remporté par André Caplet (Ravel est troisième!), a signé entre autres trois opéras et un beau cycle pour piano Les Heures dolentes. Pour ses mélodies, entre Massenet et Debussy, il emprunte les vers à Verlaine, largement privilégié, à Rimbaud, Musset, Leconte de Lisle, Klingsor, Henri de Régnier, Emile Verhaeren ou d’autres poètes d’envergure moindre. Valétudinaire, atteint par la tuberculeuse, il se plait dans la mélancolie, «la fin des espoirs, [… ] les vaines amours, / Et les songes vains [… ] et la mort des jours» (Georges Vanor, «Le Jour des morts»). Mais quelques pages savent dépasser ce climat morbide. La mélodie française relève d’un art très délicat où toute faute de goût, de ponctuation, de liaison, de respiration pourrait altérer la ligne et l’équilibre – et la beauté parfois un peu gracile – de ces frêles miniatures. Dubois et Raës, indissociables dans la réussite de l’album, réussissent pour chaque pièce à en exprimer la quintessence musicale et poétique, avec simplicité et une maitrise technique et vocale exemplaire. Que retenir des trente et une pages – soit l’intégrale – proposées par les deux complices en harmonie et en discret lyrisme? La tendresse et la justesse. Tous les Verlaine dont le premier «Le foyer», chef d’œuvre pictural où la voix se colore d’inflexions inouïes, sont une leçon de chant. On ne se lasse pas de se laisser séduire par la «Mandoline» «Parmi les frissons de brise». Les trois Richepin dans le cycle Les Caresses mêlent souvenirs pieux, érotisme discret, sensations émues, distillées par Dubois et Raës avec pudeur et sens des nuances raffiné. Barbara composant son «Pierre» se souvenait-elle du «Jardin mouillé»? La «Chanson des noisettes», fable pleine d’humour, animée telle une saynète, le dialogue entre le poète et son cœur dans la «Chanson» de Musset, à laquelle fait écho la «Sérénade à Ninon», la délicieuse «Annie», la discrètement exotique «Chanson de Myrrha» ouvrent l’éventail précieux des climats, des registres, des couleurs, des demi teintes. «La Chanson des six petits oiseaux» ne sombre pas dans la joliesse mièvre que par l’intelligence, le sens de la distinction d’amoureux lucides du compositeur. L’étonnant «Monsieur Destin» dénonce avec une ironie amère, caustique, les illusions. Tout comme dans «Pieusement» de Verhaeren ou «Ô triste, triste» (Verlaine), les deux interprètes introduisent un dramatisme douloureux de bon aloi. Écoutez enfin cette merveille d’art du dire, Crépuscule d’été, sur un texte de la seule poétesse mise en musique par Dupont, Cécile Périn. Ce qu’en fait le compositeur, avec une audace étonnante de dépouillement, relève du respect le plus total, le plus pur de la poésie, de ses rythmes, des enjambements, de la prosodie, du mystère de cette promenade embaumée. Ce que le ténor et le pianiste en traduisent relèvent de l’enchantement et de la grâce. Fade? Comme un haiku, comme un Chardin. Nous sommes au cœur de l’intimité et de l’émotion d’une vie et d’un art. «Tout meurt, / Et cependant tout me semble éternel».
Jean Jordy
Publié le 12/11/2025 à 10:51, mis à jour le 12/11/2025 à 11:08.